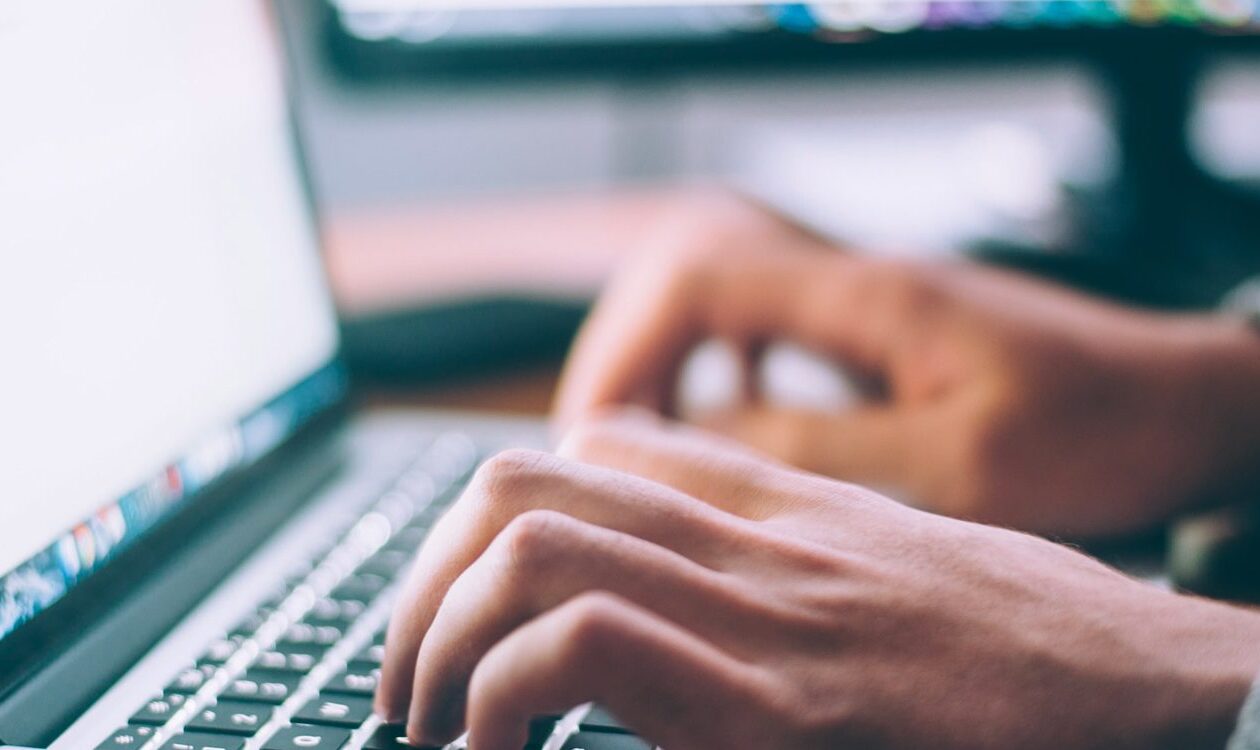Alors que la défiance des policiers envers le Ministre de l’Intérieur s’est considérablement accentuée ce mois de juin, la semaine écoulée aura été marquée par des affrontements intercommunautaires à Dijon, suivis de scènes de violence en marge de la manifestation organisée par les personnels soignants à Paris.
Dans l’un et l’autre cas, qu’il s’agisse des représentants de la communauté tchétchène qui ont justifié la brutalité de leurs méthodes en vertu d’un code de l’honneur qui leur est propre, ou des individus qui ont recherché la confrontation directe avec les forces de l’ordre sur l’esplanade des Invalides, dépossédant au passage les soignants de leur manifestation, le recours à la violence tend à s’ériger en un mode d’action et d’expression politique autonome. Depuis les manifestations contre la loi travail en 2016, des voix s’élèvent pour réhabiliter le recours à la violence. Volontiers hostiles à la figure tutélaire de l’Etat, elles ciblent plus particulièrement la Police, en ce qu’elle serait à la fois l’instrument et la personnification de l’oppression. Dans le cas particulier du mouvement dit des Gilets jaunes, des actions violentes ont été assumées et revendiquées.
L’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, la destruction du péage et du peloton de Gendarmerie de Narbonne ou encore l’intrusion violente au sein du Porte-parolat du Gouvernement au moyen d’un engin de chantier, ont été présentés comme une forme de résistance à un État jugé oppresseur. Ces mêmes accusations sont reprises sur la page Internet « Indymedia Nantes », où la mouvance anarcho-libertaire a pris l’habitude de revendiquer la série d’incendies criminels qui frappent la ville de Grenoble sans discontinuer depuis mars 2017. Plus récemment encore, ce mois de janvier 2020, l’intrusion violente, assortie de coupures d’électricité, au siège de la CFDT, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, a été justifiée dans les mêmes termes. Si les grandes centrales syndicales ont unanimement condamné la violence du procédé, les bases militantes des syndicats connues pour leurs positions plus dures, ont défendu ces actions d’intimidation par le bien-fondé de leur combat social.
Dans les trois cas, le recours à une violence avérée répondrait à la violence supposée (physique et/ou symbolique) de l’Etat. Le bien-fondé de la cause vaudrait quitus, y compris lorsque les moyens employés bafouent les opinions dissidentes ou enfreignent les lois de la République. Corollairement, ce néo-activisme institutionnalise délibérément les violences commises par des membres des forces de l’ordre. Réfutant la notion juridique de faute individuelle détachable du service, il agrège de tragiques faits divers pour étayer la thèse de la faillite générale d’un système. Les décès d’Adama Traoré en juillet 2016, de Steve Maia-Caniço en juin 2019, puis de Cédric Chouviat en janvier 2020, ont tous été interprétés comme la conséquence d’une violence institutionnalisée même si, dans les trois cas, la vérité judiciaire n’a toujours pas émergé. Ce débat s’est d’ailleurs polarisé autour d’enjeux sémantiques suscitant une controverse quant à l’usage de l’épithète « policières » pour qualifier les violences commises par des membres des forces de l’ordre. Bien qu’il existe une infraction pénale spécifique pour désigner les violences commises par des fonctionnaires de la Police nationale ou par des militaires de la Gendarmerie nationale (les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique), l’emploi d’un qualificatif générique tend à imposer un présupposé normatif selon lequel la Police serait violente par nature.
Cette allégation a pour prolongement l’indifférenciation des violences. Qu’elles soient commises par les forces de l’ordre ou par les manifestants les plus radicaux, aucune ne pourrait prétendre au monopole de la légitimité. Ce faisant, puisque les policiers et gendarmes recourent à la force avec des moyens et des équipements particuliers (prise au cou, placage ventral, grenades de différent type, lanceurs de balles de défense, etc.), les manifestants v iolents s eraient l égitimes à s ’équiper d e l a m ême manière (masques, protections corporelles, ustensiles et projectiles divers, etc.). Or, la systémisation des violences commises par des agents de la force publique sape sa capacité à agir – y compris de manière coercitive – au nom de l’intérêt général et consolide l’approche relativiste de l’ordre social, aux termes de laquelle toutes les violences s’équivaudraient. Contester le « monopole de la violence physique légitime » wébérien remet en cause le fondement même de l’État de droit, dont le conatus, au sens spinoziste du terme, n’est possible que par et dans l’exercice de la puissance publique. Face à cette dérive inquiétante pour la démocratie, force est de rappeler que, comme toute prérogative de puissance publique, le recours à la force s’inscrit dans un cadre normatif spécifique qui vise précisément à préserver le citoyen de toute dérive de la force publique.
De fait, la solidité des liens de confiance qui unissent le citoyen à sa Police s’éprouve tant par la force des règles qui encadrent l’action de cette dernière que par la rigueur des contrôles qui y sont associés. Ce n’est donc qu’à la double condition de normes restrictives et de pluralité des mécanismes de contrôle que le citoyen peut créditer les forces de l’ordre d’un « monopole de la violence physique légitime ». Au regard de la dégradation rapide de la cote de confiance des forces de l’ordre (-14% en 5 ans selon le CEVIPOF) nul ne peut nier, qu’en matière d’usage de la force, il faille collectivement repenser à la fois les normes et leur mode de contrôle.
Mais l’architecte d’un tel chantier doit rester l’Etat et ses outils, ceux du droit. En démocratie, c’est ainsi que cela fonctionne.