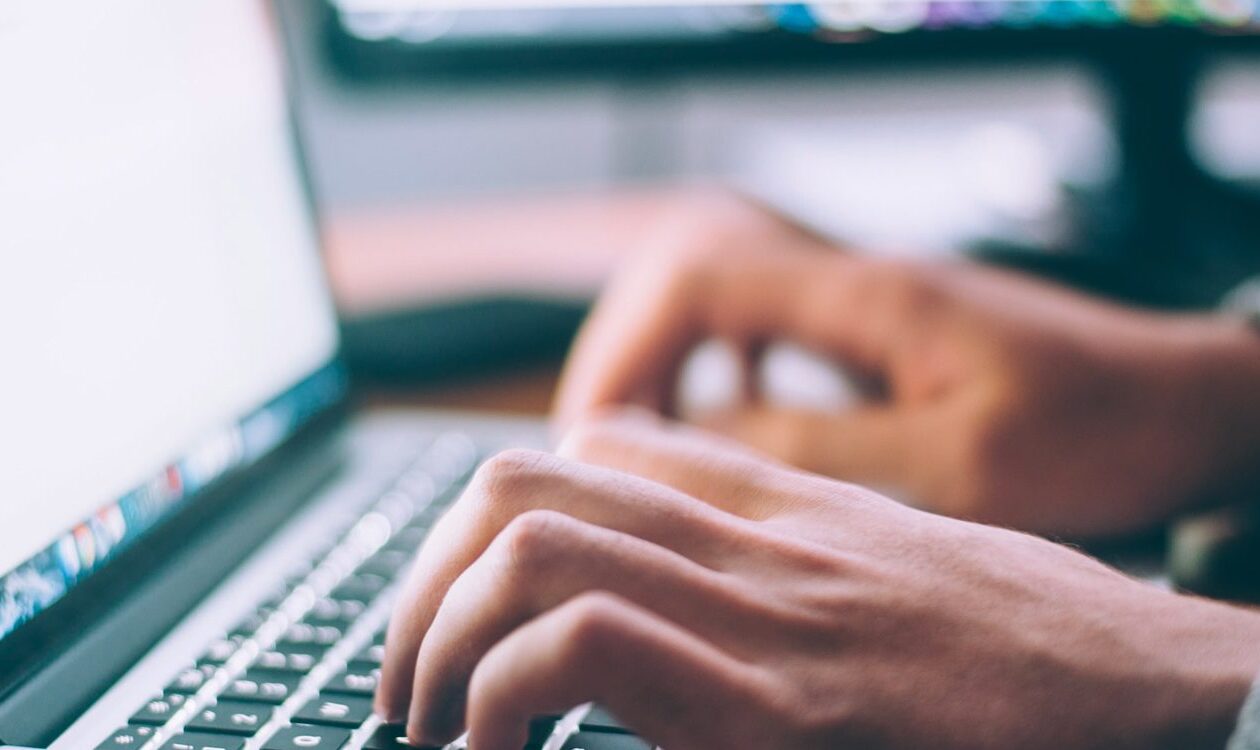Il peut paraître paradoxal de parler de désengagement américain au Moyen Orient alors que toute la région attend de connaître le résultat de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis pour définir ses options dans le grand jeu stratégique en cours dans cette partie du monde ; sans parler de la puissance militaire inégalée déployée dans la zone par la première puissance mondiale, sa politique de « pression maximale » sur l’Iran, son soutien indéfectible à Israël et ses intérêts économiques majeurs dans la région.
Pourtant le président Trump poursuit sa politique de retrait de Syrie et d’Irak – amorcée en fait par le président Obama – et il est patent qu’il existe aux Etats-Unis une « fatigue » des engagements militaires (coûteux et peu fructueux) au Moyen Orient ; d’autant plus que le pays ne dépend plus du pétrole de cette région et que la priorité stratégique de Washington – quel que soit le prochain président américain – est désormais de contrer la montée en puissance de la Chine. Face à ce désengagement en cours, on assiste à un retour des ambitions « impériales » russes et turques et à une exacerbation de la lutte d’influence entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, qui induit un rapprochement des pays du Golfe avec Israël. Naturellement la réélection ou non de Trump aura des implications importantes sur le jeu des protagonistes dans la région ; mais d’ores et déjà les observateurs s’interrogent à juste titre sur l’impact qu’aura l’effacement tendanciel américain sur la capacité des puissances régionales à acquérir une forme d’hégémonie au Moyen Orient. S’agissant de la Russie, il ne semble pas que ce soit un objectif majeur, l’activisme régional du président Poutine visant plutôt à conforter son implantation en Syrie /Méditerranée orientale, à profiter du retrait américain pour obtenir un succès diplomatique confortant le rôle international de la Russie et à promouvoir les intérêts économiques – notamment les ventes d’armes russes – dans cette partie du monde.
Quant à la Turquie, l’échec de son entrée dans l’Union Européenne, ses difficultés économiques et les rêves pan-ottomans de son président la conduisent à une politique agressive – en jouant sur le nationalisme turc – pour défendre ce qu’elle estime être ses intérêts vitaux : contenir le « danger kurde » au Moyen Orient et arracher sa part du gâteau des richesses gazières de la Méditerranée orientale. Mais son passé impérial dans le monde arabe et son ambition de prendre le leadership du monde sunnite – qui contrarie l’axe égypto-saoudo-émirien – limitent en réalité ses aspirations hégémoniques dans la région. L’Egypte pour sa part demeure un pays influent au Moyen Orient, mais l’échec du panarabisme de Nasser et sa concentration sur ses problèmes économiques intérieurs l’ont fait renoncer de facto à ses ambitions régionales. Aujourd’hui ce sont donc essentiellement l’Iran de la révolution islamique et l’Arabie Saoudite de Mohamed ben Salman (assisté de l’allié émirien) qui entendent s’affirmer comme puissances régionales au Moyen Orient.
Mais ces deux pays en ont-ils les moyens ? L’Arabie Saoudite, depuis l’arrivée au pouvoir en 2015 du Roi Salman et de son fils Mohamed, s’est engagée dans une politique de réforme socio-économique – rendue indispensable par l’effondrement du prix du pétrole – réduisant le gaspillage des ressources de l’Etat-Providence, modernisant la gestion de l’administration, développant le secteur des loisirs et commençant à exploiter le potentiel touristique, minier et solaire du pays. Elle entend aussi – après ce qu’elle a ressenti comme un lâchage du président Obama – jouer elle-même un rôle régional que lui permettent son statut de première puissance économique du monde arabe et de Gardien des Lieux Saints de l’Islam. Son objectif prioritaire est de profiter de la présidence Trump pour faire refluer l’influence iranienne dans la région, qui s’est développée depuis l’invasion américaine de l’Irak. Jusqu’à présent les autorités de Riyad avaient surtout utilisé leur chéquier pour s’opposer aux « printemps arabes » en Egypte et à Bahrein et pour financer leurs alliés dans les conflits en Syrie, au Liban et au Yémen. Avec Mohamed ben Salman, l’Arabie Saoudite s’est engagée militairement au Yémen et – avec Abou Dabi – a tenté de forcer le Qatar à renoncer à sa diplomatie autonome, sans beaucoup de succès dans les deux cas. Cela a montré les limites des capacités militaires du royaume, en dépit d’importations d’armement massives.
De même, malgré des moyens importants consacrés à promouvoir le wahabisme dans le monde musulman, le « soft power » saoudien n’a pas été très fructueux : il est antinomique avec à l’égard des Chiites et, dans le monde salafiste, Al Qaida et Daech appellent même au renversement des Saoud. Quant aux Frères Musulmans, ils sont en compétition idéologique avec le wahabisme saoudien et les pays qui les soutiennent (Turquie et Qatar) s’opposent à l’Arabie et aux Emirats Arabes Unis en Libye et au sujet de l’Egypte. L’Iran de son côté a eu plus de succès en conservant Bachar el Assad au pouvoir à Damas, en préservant son influence en Irak et au Liban – malgré les efforts américains – et en gênant l’Arabie au Yémen par son soutien aux Houthis. Cela montre que, en dépit des difficultés économiques du régime – aggravées par les sanctions américaines – Téhéran a réussi à développer des forces (Gardiens de la Révolution, Hezbollah, milices irakiennes, Houthis, supplétifs afghans et pakistanais) capables de défendre efficacement ses intérêts dans la région. Les « proxies » de l’Iran sont liés par le chiisme, l’allégeance à l’idéologie de la République islamique et l’acceptation du leadership iranien ; et ils bénéficient du soutien de leur tuteur en matière de financement, d’armement et de formation. Toutefois Téhéran souffre de plusieurs handicaps lui interdisant de prétendre à l’hégémonie régionale : La République Islamique manque de moyens par rapport à l’Arabie Saoudite, la Turquie dispose d’une armée supérieure, Israël s’oppose à ses ambitions, les sanctions américaines lui créent des difficultés économiques considérables et le chiisme est très minoritaire dans le monde musulman. Pour ces différentes raisons, ni l’Arabie Saoudite ni l’Iran n’ont en fait les moyens de devenir une puissance régionale hégémonique.
En réalité le Moyen Orient est une région multipolaire comportant au moins cinq candidats potentiels à la prédominance : L’Iran, la Turquie, Israël, l’Arabie Saoudite et l’Egypte ; chacun de ces pays ayant ses atouts et ses faiblesses. En outre la région subit l’influence de puissances extérieures telles que les Etats-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni ; et la Chine y joue un rôle croissant. En fait, si même les Etats-Unis n’ont pas réussi à préserver leur domination dans la région, il est clair que ni l’Arabie Saoudite ni l’Iran ne parviendront à acquérir un statut hégémonique. Le Moyen Orient est trop fracturé pour cela, politiquement et idéologiquement. Les Arabes, les Turcs, les Iraniens, les Israéliens et les Kurdes ont un lourd passé de récriminations réciproques. Les régimes sont de natures trop différentes pour se rapprocher et même la principale croyance commune – l’Islam – est plus un sujet de discorde que d’unité, qu’il s’agisse de la division entre sunnites et chiites et, même au sein de la famille sunnite, les divergences entre Frères Musulmans, Wahabites et djihadistes.
Dans ces conditions si certains continuent à rêver d’hégémonie régionale, la réalité du Moyen-Orient est celle d’une lutte d’influence entre puissances régionales, exacerbée par les interventions d’acteurs extérieurs comme les Etats-Unis et la Russie, et peut-être bientôt la Chine. Tout nouvel ordre dans la région ne pourra donc venir que d’un arrangement à la fois entre les principaux acteurs locaux et avec les puissances extérieures intéressées. Mais étant donné les conflits internes et les divisions idéologiques actuels, cet horizon n’est sans doute par pour demain…