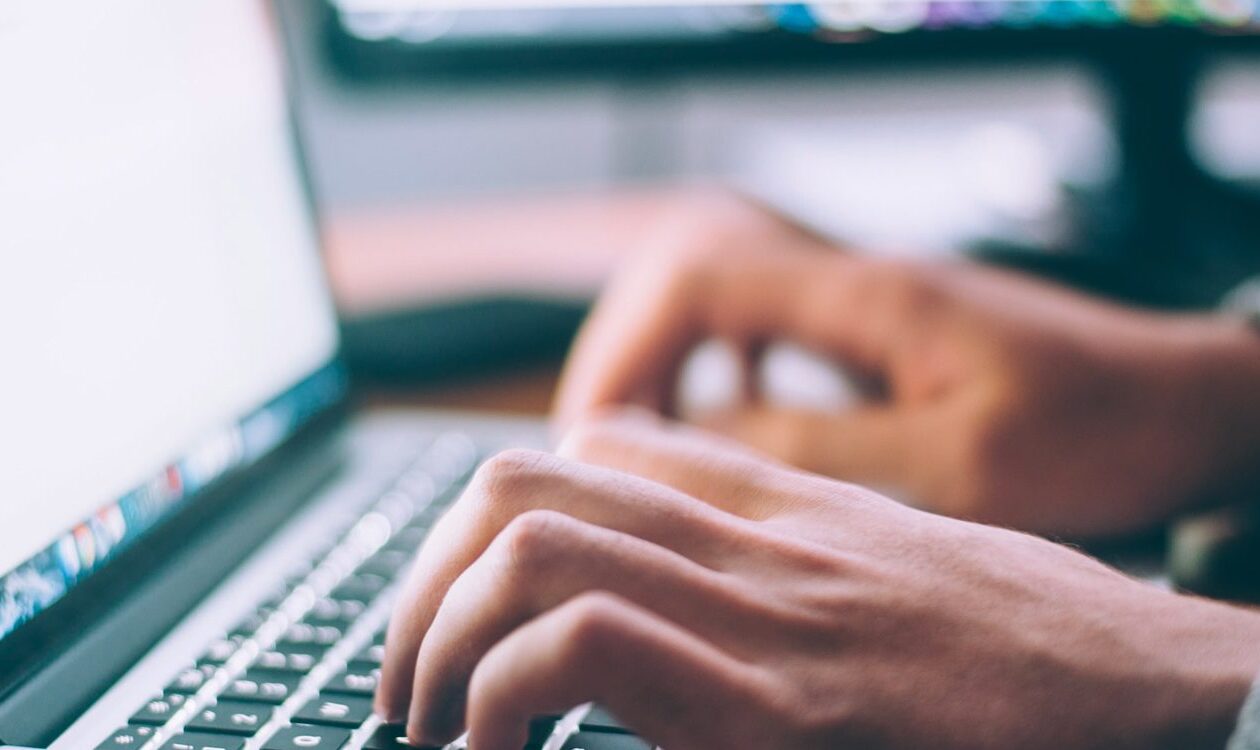Il est de certains débats en France dont nous sommes coutumiers et dont on peut avoir le sentiment qu’ils ne finissent jamais. Parmi ces débats, celui sur le mode de scrutin permettant de désigner les représentants de la nation revient régulièrement à la une de l’actualité politique au grès des élections présidentielles et des programmes des candidats. D’autres pays, parmi les démocraties les plus anciennes, ont des systèmes électoraux beaucoup plus stables.
Le Royaume Uni applique depuis plus de 150 ans son système pourtant bien injuste de scrutin uninominal à un tour. L’Allemagne a, depuis 1949, avec peu de modifications depuis, un scrutin mixte combinant scrutin uninominal à un tour et proportionnelle, en rupture avec la proportionnelle intégrale de la République de Weimar. Depuis 1787 les États Unis élisent leur chambre des représentants pour l’essentiel avec un mode de scrutin uninominal à un tour inspiré directement des britanniques. Cette stabilité tranche avec notre pays où une dizaine de réformes de scrutin législatif se sont succédées depuis l’avènement de la IIIème République. Les partisans du retour à la proportionnelle ou de l’introduction d’une dose de proportionnelle invoquent la justice et l’exacte représentation des français pour justifier de leurs propositions. Une proportionnelle intégrale serait, selon eux, le meilleur moyen que chaque français soit représenté au niveau national de la même manière.
L’instauration d’une dose de proportionnelle permettrait au moins de corriger les distorsions d’un scrutin majoritaire et l’absence de représentation de certaines sensibilités à l’Assemblée Nationale et donc de répondre, d’une certaine manière, à la crise démocratique, à la perte de confiance en nos institutions. C’est oublier un peu vite que gouverner nécessite une majorité politique et qu’en favorisant l’émiettement des partis politiques, le scrutin proportionnel ne favorise pas l’émergence de majorité et oblige donc la formation de gouvernement de coalition : 24 gouvernements en 11 ans entre 1947 et 1958 durant la IVème République. C’est également oublier que les coalitions ne se forment qu’après négociations, discussions et marchandages entre partis politiques pour en définitive appliquer une politique gouvernementale qui finit par ne plus avoir grand chose de commun avec le programme initial sur lequel ont voté les français. La crise démocratique de la IVème République aura ainsi abouti à une rupture totale de confiance entre les français et leur Assemblée Nationale, les premiers ayant estimé que la souveraineté populaire leur avait échappé au profit d’une souveraineté des partis politiques.
Ce sentiment profond est accentué par le fait que dans un système de scrutin proportionnel, le pouvoir de désigner les candidats appartient de fait aux appareils politiques et rompt le lien entre élus et électeurs d’une circonscription que l’on connaît dans un scrutin majoritaire à un ou deux tours. L’instauration d’une dose de proportionnelle en lieu et place d’une proportionnelle intégrale pourrait, peut être, permettre d’atténuer ces défauts mais nous pouvons observer que dans le système allemand, le pays pourtant habitué à la discipline, aux négociations, n’échappe pas à la difficulté de former des coalitions de gouvernement aux projets clairement établis. Il me semble finalement que l’essentiel du débat est ailleurs et qu’il faut se poser la question du rôle et de la place que les partis politiques doivent jouer dans une démocratie moderne et efficace. La Science Politique nous apprend que le mode de scrutin est plus qu’un point de détail technique mais structure durablement la vie politique du pays où il s’applique. Une proportionnelle intégrale conduit au multipartisme. Un scrutin uninominal à un tour à la mode américaine ou britannique impose un bipartisme Démocrate/Républicain ou Conservateurs/ Travaillistes. Un scrutin uninominal à deux tours, tel que le système français, produit un système bipolaire gauche/ droite dont il est difficile de s’extraire. Au-delà de ces principes intangibles et qui ne souffrent guère d’exceptions, des régimes électoraux mixant ces différents modes de scrutin produisent des résultats intermédiaires. Nos nombreux changements de mode de scrutin s’expliquent par la difficulté à stabiliser nos institutions. Les fins tragiques ou difficiles de la Troisième et de la Quatrième République ont conduit notre pays à vivre une certaine forme de traumatisme vis à vis des partis politiques.
Le Général de Gaulle l’a exprimé avec beaucoup de talent, nous nous en souvenons, à l’occasion d’un entretien télévisé avec Michel Droit le 15 décembre 1965, quatre jours avant le deuxième tour de l’élection présidentielle : « Entre monsieur Clemenceau et monsieur Paul Reynaud c’est-à-dire de 1920 à 1940, on a eu quarante sept ministères en vingt ans. Voilà le régime des partis. Alors naturellement, on a été battus, écrasés. En 40, on n’avait rien préparé, on était divisé par les partis. On n’avait pas les armes nécessaires ». Nous nous souvenons aussi du discours de Bayeux, le 16 juin 1946, où de Gaulle exprimait avec force ce que devait être, selon lui, le fonctionnement de nos institutions et qui annonçait la Vème République : « En vérité, l’unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l’autre pouvoir auquel il doit faire équilibre et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n’était, à son poste, que le mandataire d’un parti ? » Il est intéressant de constater que les institutions gaulliennes de la Vème République et le régime semi présidentiel, avec un parlementarisme rationalisé autour d’un scrutin uninominal à deux tours, n’aura pas permis, lui non plus, de trouver cette stabilité institutionnelle que l’on peut envier aux Anglo Saxons. Bien sûr l’efficacité de ce régime aura permis à des majorités de gouverner, même lorsqu’elles sont devenues temporairement « minoritaires » dans l’opinion. Mais la bipolarisation aura en définitive durablement divisée la France en deux blocs, souvent tirés vers les extrêmes et laissant s’installer une profonde insatisfaction démocratique.
L’élection d’Emmanuel Macron, le 7 mai 2017, ouvre une nouvelle page de cette histoire politique et de ces rapports complexes entre les français et leurs institutions. Son élection est une élection en dehors des partis politiques et contre les partis politiques traditionnels à un moment où ces derniers ont massivement perdu la confiance des Français. L’intuition impressionnante de Macron est que, en dehors de toute attache partisane, une rencontre directe, très gaullienne finalement, avec les Français pouvait être gagnante.
Emmanuel Macron n’aime pas les partis politiques et n’a pas réellement souhaité depuis créer de parti politique présidentiel. En Marche est d’abord un mouvement, un espace collectif, un instrument de campagne et lorsqu’il est obligé, pour des raisons institutionnelles de se transformer en parti politique, il n’est ni réellement aidé, ni soutenu par le Président de la République qui ne nomme même pas de Premier Ministre émanant de ses rangs. Comment s’étonner dès lors de la succession d’échecs électoraux à l’exception notable bien sûr de l’élection législative ayant suivi l’élection présidentielle et d’une élection européenne mitigée. C’est à l’aune de ces éléments que s’inscrit le débat sur l’instauration d’une dose de proportionnelle dans notre mode de scrutin.
Le Président Macron n’en veut pas car cela ne correspond pas à sa lecture des institutions à la fois moderne (des formes de démocratie directe ou digitale) mais aussi assez gaullienne (un Président qui ne dépend pas des partis). Le programme du candidat Macron de 32 pages ne comportait d’ailleurs pas de promesse de réforme de scrutin et d’introduction de dose de proportionnelle. Ce n’est que sous l’insistance de François Bayrou, pour négocier son ralliement, que le candidat Macron en a accepté le principe, du bout des lèvres. Elle ne sera donc pas introduite, en tout cas pas dans ce mandat. Cela ne changerait de toutes les façons pas grand chose à la crise démocratique que nous connaissons. Cette crise n’est évidemment pas une affaire de mode de scrutin. De la crise des gilets jaunes à l’envahissement du Capitole, des nouvelles formes d’expression digitales aux fake news en passant par les adeptes des théories du complot, cette crise n’est ni simplement française, ni attachée à un régime politique. Toutes les démocraties modernes sont confrontées, de façon concomitante, aux mêmes défis.
La parole politique est mise en doute et en échec, les partis politiques ont perdu une grande partie de leur crédibilité et peinent à inventer de nouvelles formes de militantisme, d’actions, de dialogue avec les électeurs. Un mouvement nouveau comme la République en Marche, inspiré d’un Président jeune et nouvellement élu, aurait pu avoir cette ambition. Le fait est que ce n’est pas la voie choisie. Dose de proportionnelle ou pas, le débat paraît ainsi quelque peu dérisoire à un moment où la réponse aux défis immenses de la crise démocratique nécessite une adhésion retrouvée de nos concitoyens aux institutions politiques de notre pays.
A force de vouloir bouger ou adapter ces institutions, nous en oublions que leur force vient souvent de leur stabilité, que leur légitimité se nourrit de leurs racines et de leur histoire, leur permettant ainsi de maintenir une forme acceptée de contrat social.