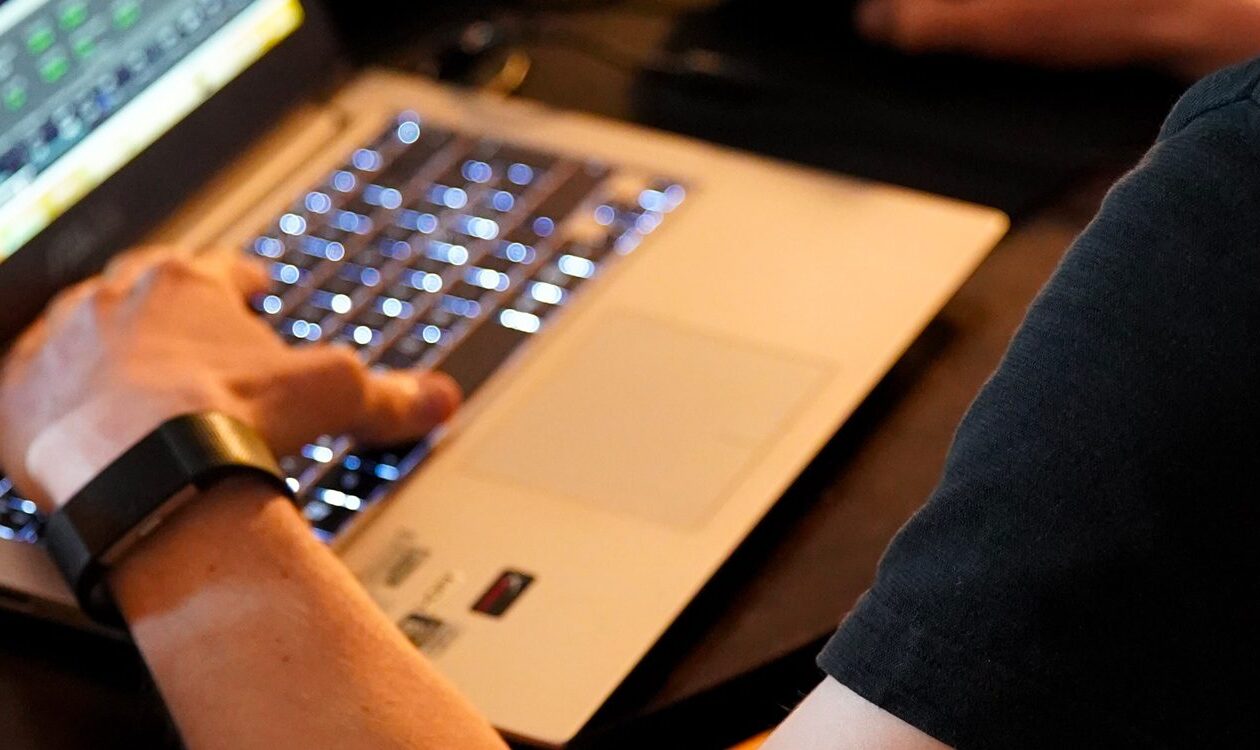
« Nous devons trouver le bon équilibre entre les objectifs à atteindre et la durée de notre déploiement »
Saint-Cyrien, marsouin, le général Didier Castres a participé, de 2009 à 2016, à la planification et à la conduite des opérations conduites par la France et ses partenaires en Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en Libye, au Mali, en Centrafrique, en Irak et en Syrie.
Question : Comment les chefs d’Etats successifs ont-ils abordé, à leur manière, la lutte antiterroriste ?
L’engagement militaire de la France dans la lutte contre le terrorisme à l’extérieur de ses frontières a débuté au début des années 2000, en Afghanistan contre Al Qaida, puis au Sahel enfin en Irak et en Syrie où nous avons combattu Daech et Al Nosra, la franchise d’Al Qaida. Cela fait maintenant plus de vingt ans que nous sommes engagés dans cette lutte. Au départ, et comme beaucoup de pays occidentaux, nous nous sommes engagés aux côtés des Américains par solidarité après les attentats du 11-septembre plus qu’en réaction à des menaces directes à nos propres intérêts. Le président Jacques Chirac y est allé à reculons, son successeur Nicolas Sarkozy de manière plus affirmée. Pendant le quinquennat de François Hollande et en raison des attentats qui ont ensanglanté notre pays, cela a confiné à la frénésie frôlant parfois l’hystérie. Quant à l’actuel président, après avoir été confronté à l’épreuve de la réalité du théâtre sahélien, il a adopté une posture active, mesurée et constante.
Quel bilan tirez-vous de ces opérations françaises de lutte anti-terroriste ?
Les enseignements sont de plusieurs ordres. D’un point de vue très général et quasi anthropologique, le premier est de comprendre que le seul levier militaire – en tout cas dans les démocraties – ne peut avoir raison de l’idéologie qui anime les groupes terroristes. La force militaire contient, sépare, affaiblit, bloque mais elle ne règle pas les questions de misère, d’injustice, de mal-gouvernance et de delirium. Le second est de nature militaire. Nous luttons contre des adversaires qui pratiquent une guerre asymétrique dans toutes ses dimensions (moyens, valeurs, modes d’action, lois…). Par ailleurs, nos ennemis refusent le plus souvent le combat frontal et excellent dans la capacité de se diluer au sein des populations puis brutalement de se concentrer pour conduire une action et enfin de s’évaporer dès que leur méfait est accompli. Dans de telles conditions, la notion même de victoire militaire devient illusoire ou pour le moins jamais définitive. Je garde toujours en tête le premier attentat revendiqué par Al Qaida. C’était en 1992 au Mövenpick Hotel de Sanaa. Trente ans plus tard, nous ne sommes toujours pas parvenus à éradiquer cette nébuleuse islamiste.
« Plus aucun pays, le plus puissant soit-il, n’est capable de régler, seul, les crises liées au terrorisme d’inspiration islamiste »
Si l’on partage votre appréciation, alors que doit-on faire ?
En premier lieu, nous devons faire un effort de lucidité et d’humilité collectif pour nous fixer des objectifs politiques et militaires pragmatiques et atteignables. Il faut s’extraire de cette ambition certes louable mais qui consiste à vouloir transformer tout pays en crise en « canton suisse ». Et dans le prolongement de ce premier principe, nous devons trouver le bon équilibre entre les objectifs à atteindre et la durée de notre déploiement, sachant qu’invariablement au bout d’un certain temps les forces étrangères deviennent une partie du problème qu’elles sont venues résoudre.
Ensuite, il nous faut tirer les enseignements du caractère multidimensionnel des crises. Aujourd’hui, la seule action militaire est tout à fait insuffisante et plus aucun pays, le plus puissant soit-il, n’est capable de régler, seul, les crises liées au terrorisme d’inspiration islamiste. Il nous faut rentrer de façon beaucoup plus volontaire dans le monde de « l’inter » : interservices, interministériel, international, inter secteur public et secteur privé et sur cette base, mettre en œuvre des solutions intégrées et pas simplement des empilements d’actions. Enfin, nous devons repenser notre relation avec le pays au secours duquel nous intervenons dans une logique transactionnelle plus affirmée.
S’agissant du cas spécifique du Mali, j’ai le souvenir, avant le déclenchement de l’opération Serval, d’avoir évoqué quatre prérequis pour espérer un succès global : un accord de paix sincère, une solution qui ne pouvait se faire ni sans, ni contre l’Algérie, la fermeture des flux d’armement, de combattants et d’idéologie en provenance de la Libye et une profonde transformation de la gouvernance au Mali. Deux ou trois coups d’Etat plus tard, rien de ce qui incombait à l’Etat malien n’a avancé.
La justification politique de ces interventions a-t-elle été honnête envers le public français ?
C’est une question à laquelle il serait caricatural de répondre par oui ou par non. On ne peut pas d’un côté accuser l’Etat d’insuffisamment anticiper les crises et de l’autre lui reprocher d’intervenir avant qu’une catastrophe n’ait lieu. Que se serait-il passé, d’abord en Afrique de l’Ouest puis en France, si nous n’étions pas intervenus au Mali en 2013 ? Fallait-il attendre «un Bataclan» prémédité depuis l’Adrar des Ifoghas ? Etait-ce une hypothèse crédible ? Personne ne le sait même si tout le monde spécule. Mais probablement, le narratif politique a été accentué pour faire la pédagogie de nos engagements majeurs au Levant et au Sahel. La difficulté de la communication politique lors d’opérations militaires extérieures, est double : il faut d’une part convaincre les populations auprès desquelles on intervient de l’apport de forces étrangères et d’autre part convaincre sa propre opinion publique de la nécessité de ces interventions. Au fil du temps, le challenge devient de plus en plus exigeant.
« Que dirait-on si une armée étrangère opérant sur notre sol faisait des annonces régulières sur les éliminations de Français soupçonnés de terrorisme ? »
Le fait de communiquer sur le nombre de terroristes tués ne se retourne-t-il pas contre la France ?
Il ne s’agit évidemment pas de critiquer la neutralisation de nos ennemis ou de se l’interdire, nous ne sommes pas dans Utopia de Thomas More. Mais nous devons être conscients que cette stratégie s’apparente au mythe de Sisyphe au titre de ce que j’appelle « l’arithmétique de la rébellion ». Il s’agit là d’une règle de la grammaire de la contre-insurrection qui veut que pour un chef local éliminé, on fasse se lever dix nouveaux combattants, son frère, son père, son oncle et ses cousins, etc. Il est probable que les effectifs des groupes terroristes, aujourd’hui, soient supérieurs à ce qu’ils étaient en 2013. Enfin, en termes de communication, l’acceptabilité locale de ces annonces pose question quand c’est la France qui communique sur ces bilans. Que dirait-on si une armée étrangère opérant sur notre sol faisait des annonces régulières sur les éliminations de Français soupçonnés de terrorisme ? Si cette communication est nécessaire, c’est le pays hôte qui doit en être à l’origine. Ceci pose la question de savoir quelle est la finalité de la communication : politique intérieure ou politique étrangère. En tout cas, les deux sont difficilement fongibles.
Que préconisez-vous à l’heure du départ d’Afghanistan et de la réarticulation du dispositif français au Sahel en raison de la montée du sentiment anti-français ?
D’abord, et l’agression russe contre l’Ukraine en est l’avatar le plus récent, nous devons intégrer trois nouvelles dimensions du cadre géopolitique. La première, c’est désormais de vivre et penser avec une épée de Damoclès d’incertitude stratégique au-dessus de nos têtes. La deuxième, c’est de prendre conscience du retour de la force comme le principal levier de la résolution des crises, quelle que soit la nature de la force. La résolution des crises par les voies du dialogue et de la diplomatie s’éloigne pour un temps. Et la troisième, c’est de se préparer à être happés par les crises et non plus de choisir celles dans lesquelles nous voulons nous investir ; en fait passer d’une logique de guerre de choix à celle d’une guerre d’obligation. Pour avoir planifié et dirigé les opérations au Sahel, je me garderai bien de donner des conseils à ceux qui en ont la charge. Par ailleurs, je pense que la sécurité et l’efficacité de nos opérations reposent sur leur confidentialité. On donne souvent à travers la communication publique beaucoup d’information à ceux que nous devons combattre. Alors, je reprendrai ce bout de phrase d’Alfred de Vigny : pour les opérations, « seul le silence est grand ».
Parution dans l’Opinion le 03 avril 2022





