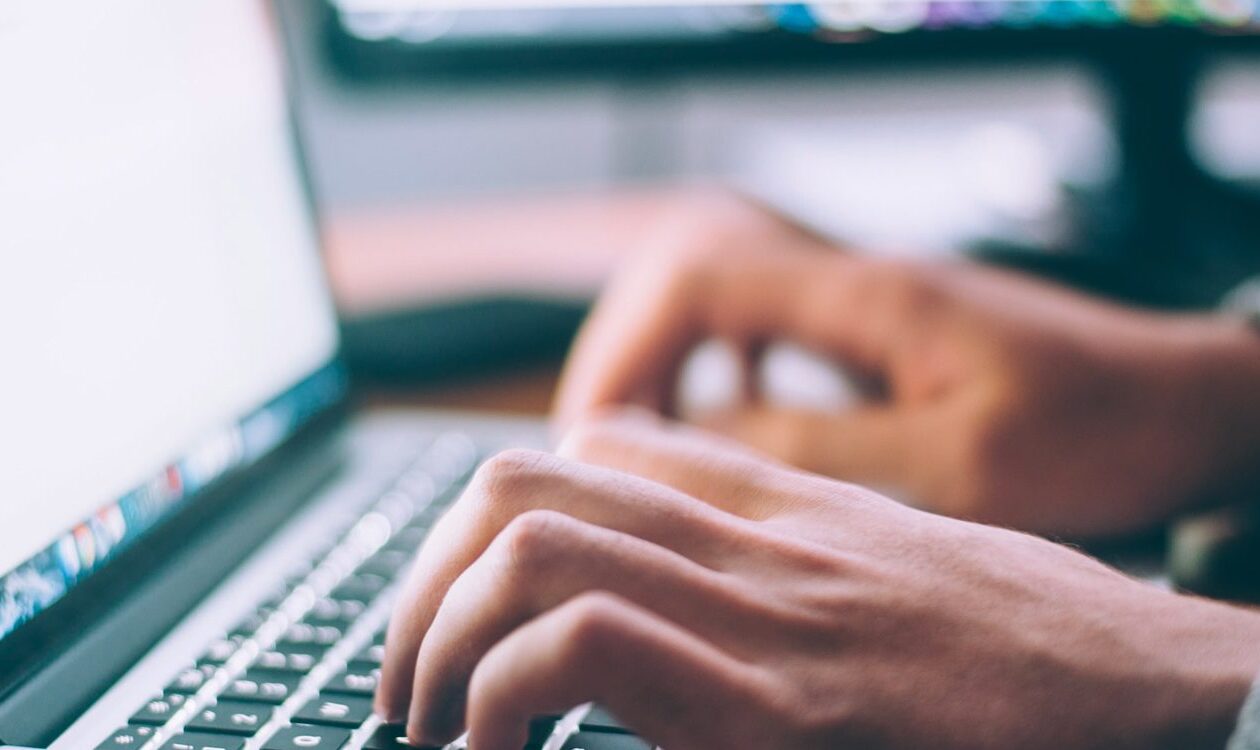
Interview : Général Didier Castres (2/2) « Je ne pense pas qu’une nouvelle guerre froide entre un Bloc de l’Est contre les pays de l’Ouest puisse encore avoir un sens. »
Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est un ancien élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (promotion Montcalm 1980 – 1982). Après un début de carrière classique pendant lequel il alterne affectations en France, à l’Étranger et en opérations extérieures, il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant plus d’une dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion des crises internationales dans leur dimension militaire : à l’Élysée avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme chef du centre de planification et de commandement des opérations (CPCO) à l’état-major des armées et enfin comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution militaire, il crée en 2020 un cabinet de conseil (DC TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense et de sécurité nationale dont les services sont essentiellement destinés aux États africains. Le 1er septembre 2020, il rejoint le groupe ESL & Network comme Senior Advisor.
Dans le précédent numéro de notre Newsletter du jeudi 10 mars, le général Didier Castres dresse un panorama de l’action militaire russe dans le monde, à travers son armée et via le groupe paramilitaire Wagner, notamment en Afrique et dans les zones grises où l’Occident n’a pas su se doter de forces d’intervention similaires. Il fait ainsi état d’une stratégie militaire russe en Afrique – théâtre de règlements interétatiques et d’opérations d’influence à l’international où le groupe Wagner prospère – différente de l’Ukraine où l’armée russe avance à visage découvert.
Depuis quelques jours, les commentateurs comparent la situation de l’Ukraine avec les revers de l’Afghanistan pour Joe Biden et du Mali pour Emmanuel Macron.
Général Didier Castres. Ce parallèle est très abusif. Machiavel disait, « on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». Mais le départ du Mali n’est pas comparable à celui d’Afghanistan. La France ne part pas sous la pression d’une rébellion sur le point de conquérir le pouvoir. Elle ne part pas non plus dans le cadre d’une décision unilatérale. Tout cela a été discuté, débattu avec tous les alliés et partenaires qui sont engagés pour résoudre cette crise.
Mais, pour en revenir à la maxime prêtée à Machiavel, il est capital, avant même le déclenchement d’une opération militaire, d’identifier les critères qui nous décideront à réarticuler notre dispositif voire même à quitter le théâtre des opérations. Nous devons très vite identifier les ‘’bretelles de sorties’’ de notre engagement militaire. Ceci suppose d’être lucide sur nos capacités stabilisatrices et pragmatiques dans les objectifs que l’on se fixe.
Nous aurions eu de bons arguments pour réduire très sensiblement notre empreinte au Mali ; d’abord après avoir chassé les groupes djihadistes des principaux centres urbains du Mali et avoir désarticulé leur organisation ; ensuite après les élections de 2013 au cours desquelles les Maliens s’étaient donné un président de la République reconnu par la communauté internationale, enfin après avoir tué les chefs des deux principaux groupes djihadistes.
Vous avancez que la plupart des pays occidentaux n’ont pas pris conscience de cette érosion du droit et des outils alternatifs mis en place par d’autres. Soit le régalien, soit rien. Qu’entendez-vous par cela ? Diriez-vous que c’est l’explication de la fin de l’aventure malienne pour la France ?
S’agissant du Mali et des critiques qui fusent actuellement de toute part, accompagnées de cette délectation de beaucoup à se complaire dans la ‘’défaite et l’échec’’ de la France et si votre question est : « Est-ce que nous avons tout bien fait ? », ma réponse est : « Non. » Non, nous n’avons pas tout bien fait, oui nous avons commis des erreurs car nous de sommes pas des Elfes, même si visiblement nous ne sommes entourés que par des personnes parfaites…
Mais revenons à ce qui nous vaut cet opprobre. Le dénouement de la crise afghane et les perspectives en Afrique de l’Ouest marquent la fin des illusions. La première est celle du Nation Building. C’est de croire qu’on peut importer et imposer un système politique, économique, social et sociétal à n’importe quel pays. En fait, c’est croire que l’on peut transformer tout pays en canton suisse. La deuxième c’est d’avoir cru ou voulu croire qu’élections rimait avec démocratie et démocratie avec paix et prospérité et ce, de façon universelle. En Afrique et à de très rares exceptions, ceci est faux. Ensuite, il y a l’écume des jours à laquelle nous n’avons pas suffisamment prêté attention. Et pour commencer, la durée de nos interventions. Toutes les forces étrangères dans un pays, au-delà d’une certaine durée, passent du statut de solution à la crise à celui de partie du problème. Ensuite, nous avons longtemps pensé, trop longtemps, que nous pourrions résoudre militairement la crise.
Or, une des leçons tirées des crises récentes est que le principal facteur de supériorité opérationnelle réside dans la capacité de coordination de tous les leviers qui agissent sur une crise ; la force militaire, l’instauration d’un État et d’une gouvernance correspondant aux attentes du pays en crise, les investissements, le soutien au secteur privé, etc…. Si nous maîtrisons quelques ‘‘portées’’ de la partition, notamment la coordination entre ministère des armées et ministère des affaires étrangères, il nous reste encore du chemin à faire, d’abord au sein de l’État français mais également dans le champ international. C’est probablement celui qui est capable de coordonner le plus précisément le plus grand nombre de domaines qui est le plus proche de la solution.
Sur le Mali et maintenant sur l’Ukraine, Emmanuel Macron semble le seul à vouloir agir concrètement en tant que leader européen. On pourrait en tirer une fierté française. Mais, le chef de l’État tient absolument à en faire une fierté européenne. Est-ce une erreur stratégique pour le président Français ?
Vous m’en demandez beaucoup et je ne pense pas être apte à juger des erreurs stratégiques du président de la République… Ce qui est incontestable, c’est qu’il porte la voix de notre pays et de facto de l’Union européenne – en tout cas en ce moment – aux tables de la diplomatie internationale. Mais nous voyons aussi aujourd’hui que le rapport de force redevient un levier puissant des relations internationales et de la résolution des conflits. Dès lors, il faut se voir comme on est, avec humilité et lucidité ; ce qui ne doit rien enlever à notre volonté d’aboutir et de défendre nos positions. Mais je ne suis pas persuadé que l’Union européenne ait cette volonté de puissance, en témoigne la nature et le niveau d’ambition, dans le domaine militaire, des opérations conduites sous la bannière UE. Par ailleurs, il me semble difficile de s’ériger en puissance d’équilibre entre les ‘‘grands’’ et simultanément d’intégrateur ou de développeur de la puissance européenne.
Comment expliquez les victoires ou le bilan positif obtenu sur l’opération Barkhane ? Ils existent, et pourtant, personne n’insiste jamais dessus.
Quand la décision a été prise d’intervenir au Mali, nous savions que nous allions être confrontés à un cancer djihadiste qui avait brutalement proliféré. Les effectifs d’AQMI avaient été multipliés par deux entre 2007 et 2012, ceux d’Ansar Dine avait augmenté de 30 %, quant à Al-Mourabitoune, ses effectifs ont été multipliés par 10 en deux ans. Au cours de l’opération Serval, nous avons saisi des centaines de tonnes de munitions, des centaines d’armes, des chaînes complètes de construction d’engins explosifs improvisés, etc…Il est toujours difficile de prévoir ce qui se serait passé sans l’intervention de Serval, en tout cas cette opération a interrompu la construction d’une base arrière du terrorisme international en Afrique de l’Ouest. Ensuite et pour prendre des comparaisons certes un peu grossières, nous avons tué, à défaut de ne pas avoir pu les prendre vivants, Abdelmalek Droukdel, le chef d’AQMI, l’Oussama Ben Laden local et Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, le chef de l’État Islamique au Grand Sahara, le Al-Baghdadi local. Ils étaient les deux grands chefs internationalistes au Mali. Bien sûr cela n’est pas suffisant, cela n’est jamais suffisant.
Ensuite, lorsque nous sommes arrivés, l’armée malienne comptait 7000 hommes dont on ne peut pas dire qu’ils avaient une grande capacité opérationnelle. Aujourd’hui, les forces de défense et de sécurité maliennes comptent 40 000 hommes.
Par ailleurs, rappelez-vous de la vague d’attentats des années 2015 et 2016, qui avaient ensanglanté Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam en Côte d’Ivoire. Depuis six ans, plus aucun attentat de cette nature n’est intervenu dans une capitale des pays du G5 Sahel. Est-ce le résultat de l’action de la France ? Pas uniquement, mais nous y avons participé.
Avec l’opération Barkhane, la France menait une lutte de contre-guérilla contre un ennemi sous-équipé et très mobile. Avec la guerre en Ukraine, notre pays redécouvre les conflits de haute intensité face à une armée pleinement constituée. L’armée française est-elle préparée à une telle conflictualité ?
La loi de programmation militaire a permis de réparer les armées, selon l’expression consacrée, qui avaient connu une lente et continue hémorragie budgétaire depuis la fin de la guerre d’Algérie. Au terme de cette LPM, il faudra s’interroger sur le modèle d’armée dont notre pays aura besoin pour les quinze à vingt années qui viennent. La principale difficulté de l’exercice et d’avoir un modèle capacitaire qui permet de faire face aux enjeux du moment sans sacrifier la réponse aux menaces de demain et réciproquement. Les armées doivent se modeler sur la courbe des événements sans perdre de vue les menaces de demain. Quant à la capacité à être engagée dans un conflit de haute intensité, c’est une question qui mériterait d’être précisée : ‘‘contre qui et avec qui’’ sont évidemment les deux premières questions à se poser.
Parution dans Valeurs Actuelles le 05 mars 2022




