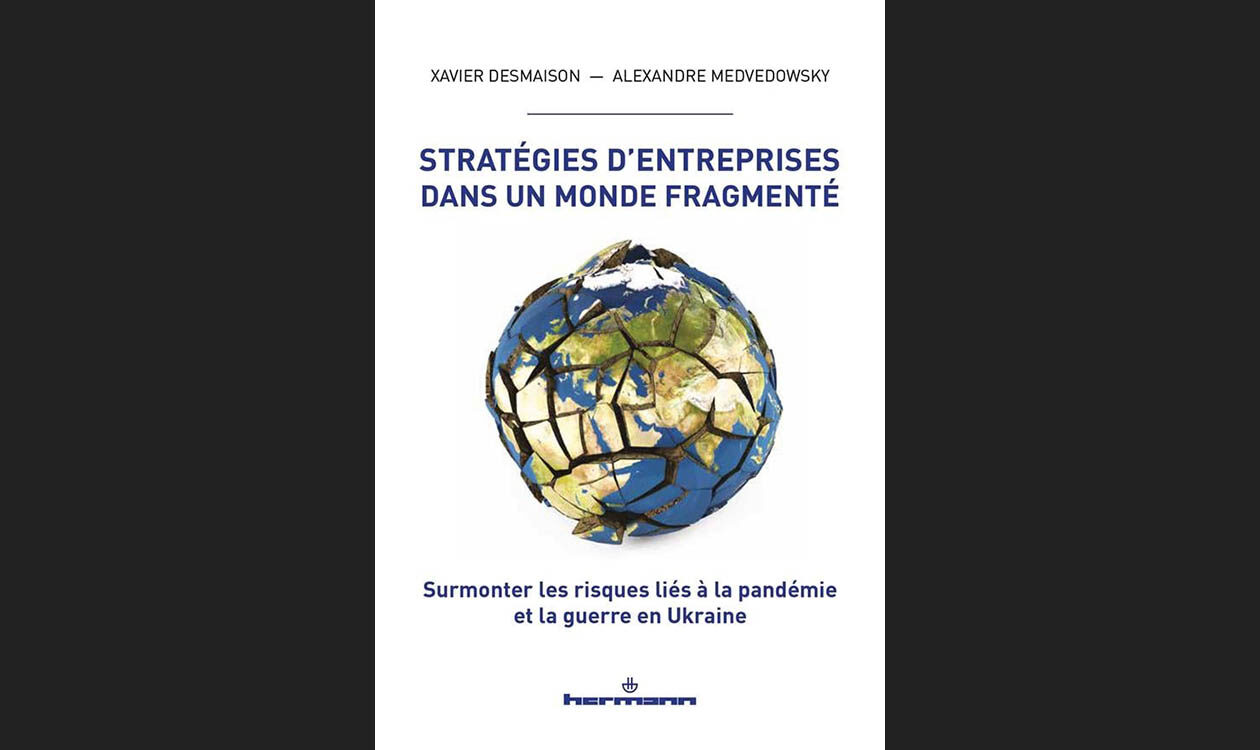A l’occasion de la sortie du livre coécrit par Xavier Desmaison et Alexandre Medvedowsky Stratégies d’entreprises dans un monde fragmenté. Surmonter les risques liés à la pandémie et la guerre en Ukraine, aux éditions Hermann, nous avons pu les interroger sur la fragmentation du monde qu’ils décrivent, et sur les notions de diplomatie d’affaires, souveraineté et soft power, abordées dans le livre.
Le titre de votre livre est : « Stratégies d’entreprises dans un monde fragmenté ». Quels sont les facteurs de fragmentation que vous mentionnez ? Et quels impacts ont-ils pour les dirigeants ?
Alexandre Medvedowsky : Ce que l’on a voulu dire dans cet ouvrage, c’est que les grilles de lecture traditionnelles de la géostratégie mondiale ont un peu changé. Par le passé, les choses étaient assez claires, notamment au moment de la Guerre Froide avec le monde libre, opposé au monde communiste. Désormais, même si on a encore des chocs de grandes puissances, comme en témoigne le dialogue musclé entre la Chine et les Etats-Unis, les entreprises doivent se rendre compte que le monde est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. Cette « fragmentation » vient d’une tectonique géostratégique internationale très complexe. Cela ne se résume pas seulement aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis ; il y a actuellement une guerre sur notre continent entre la Russie et l’Ukraine qui a un impact très lourd sur le monde économique et les entreprises ; en Afrique – zone d’influence pour la France et les entreprises françaises – il est également très compliqué d’avoir une grille de lecture car de nombreux intérêts s’y superposent (présence chinoise ; intérêts américains ; grands miniers australiens, russes et canadiens ; guerre d’influence entre la France et la Russie ; présence croissante du Qatar et de la Turquie) ; en Asie et notamment dans la zone pacifique, il y a également une complexité des rapports entre l’Inde, la Chine, la Russie et les Etats-Unis.
Tous ces exemples montrent que les entreprises doivent comprendre que la fragmentation du monde est la principale caractéristique à prendre en compte aujourd’hui, puisque celle-ci a un impact très lourd sur la vie des entreprises.
Xavier Desmaison : Nous avons choisi le terme de « fragmentation » car c’est ce qui reflète aujourd’hui la déstructuration de notre système mondial tel qu’il s’est progressivement construit après l’effondrement du système soviétique. Cette déstructuration change fondamentalement la stratégie des entreprises. Si celle-ci était déjà à l’œuvre avant la crise sanitaire, nous pouvons dire que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont complètement accéléré la construction d’un nouveau paradigme pour les quarante à cinquante prochaines années. Nous avons assisté à l’émergence progressive d’une mondialisation régulée grâce à des institutions internationales, un droit international, des normes, etc. ; et rentrons désormais dans une guerre économique très claire, dans des mouvements de relocalisation, dans une fragmentation des chaînes de valeur et des chaînes logistiques. Aujourd’hui, chacun a compris qu’il faut éviter d’installer toutes ses usines dans un seul et même pays pour travailler la résilience – c’est par exemple la fameuse mode du « China +1 ». Nous avions la construction d’une gouvernance internationale et nous rentrons désormais dans une fragmentation et une concurrence des droits. Nous avions une baisse tendancielle des prix et des barrières ; et assistons désormais à un retour des frontières et des approches compétitives entre Etats. Nous ressentions une baisse de la conflictualité ; et nous assistons maintenant à un retour des conflits de haute intensité avec une généralisation des approches guerrières dans tous les domaines de la vie. Cela rejoint la théorie chinoise de « guerre hors limite » des années 1990, qui prône une diffusion de la guerre qui touche aux espaces mentaux, à l’information, etc. De fait, une entreprise ne peut plus espérer agir dans un cadre juridique international sécurisé, qui pouvait apparaître comme l’un des points de fuite des stratégies. Il faut donc repenser les approches locales, Etat par Etat, zone par zone ; insister sur la légitimité dans le temps long en comprenant que les rapports entre Etats et communautés locales vont varier dans le temps ; développer des stratégies dans les champs cognitifs et informationnels ; pouvoir défendre ses points de vue en permanence. Par conséquent, il faut connaître ses zones de force, définir sa colonne vertébrale, ce que l’on défend et ce que l’on rejettera et clarifier ses intérêts. Qui choisir, s’il le faut, entre la Chine et les Etats-Unis ? Faut-il quitter ou pas la Russie ? Est-ce le rôle des entreprises de prendre des positions politiques, comme la défense de droits sociaux de minorités, la promotion de l’immigration, la diffusion de la démocratie, comme l’ont fait de nombreux dirigeants à rebours ? « Si les hommes d’affaires ont une responsabilité autre que celle du profit maximum pour les actionnaires, comment peuvent-ils savoir ce qu’elle est ? », écrivait Milton Friedman dans les années 1960. Comment définir puis assumer ces positions ? Les questions stratégiques à clarifier, qui relèvent, d’une certaine façon, de la diplomatie, ne manquent pas.
Vous parlez beaucoup de « diplomatie d’affaires », « diplomatie d’entreprises » ou encore de « dirigeant diplomate ». Les qualités de dirigeants et diplomates sont-elles aujourd’hui indissociables ?
AM : Les termes « diplomatie d’affaires » et « diplomatie d’entreprise » sont largement employés dans notre ouvrage car ils correspondent au monde fragmenté que l’on vient de décrire. L’objectif n’est pas de prendre le contre-pied d’autres thématiques. Xavier Desmaison a longuement parlé du langage guerrier dans sa réponse précédente – on mentionnait plus tôt les batailles de normes, les batailles juridiques –, on voit bien que l’on se trouve dans un système de confrontations. Néanmoins, à savoir si un chef d’entreprise doit être plus militaire ou plus diplomate, il y a un vrai débat. Dans cet ouvrage, nous montrons que le champ de la diplomatie n’est pas négligeable lorsque l’on est chef d’entreprise. Il faut en effet être armé, mais il faut également consacrer du temps et des efforts dans la présence et dans les discussions afin de faire bouger les lignes. Il y a aujourd’hui une nécessité d’aller au sein des organisations multilatérales et régionales (Union européenne, Union Africaine), qui sont des endroits propices aux discussions, et où le chef d’entreprise ne doit pas hésiter à se positionner sous peine de se faire imposer des règles, des discussions, des normes, des règlements qui peuvent nuire à son efficacité. Le chef d’entreprise doit également, bien entendu, établir un dialogue avec l’Etat pour lui donner des explications et négocier avec lui. Lorsque l’on parle comme aujourd’hui de taxation sur les superprofits en France ou à Bruxelles, ou encore de taxonomie à Bruxelles, on se rend bien compte que la place des entreprises est dans la discussion ou le compromis.
La diplomatie doit donc être aujourd’hui l’une des qualités d’un chef d’entreprise. Si celui-ci n’est pas un diplomate, alors il doit au moins s’entourer de collaborateurs ou de prestataires pour accompagner son entreprise sur tous les terrains de confrontation où elle se trouve.
XD : Il est effectivement évident qu’il faut être plus diplomate que guerrier aujourd’hui, pour des dirigeants d’entreprises. Et ce n’est pas de la naïveté mais du pragmatisme ! Si l’on répète tout le temps que nous sommes en guerre, on ne peut pas travailler de façon pertinente et suffisamment fine avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Les méthodes de la diplomatie paraissent donc plus adéquates aujourd’hui pour plusieurs raisons :
Premièrement, un des enjeux majeurs aujourd’hui est d’être persistant sur le temps long pour atteindre des objectifs stratégiques (de vente de matériel, d’installation d’usines, etc.). Nous savons que dans tel ou tel pays, un nouveau gouvernement peut se mettre en place ; de nouveaux rapports de force peuvent s’installer. Il faut donc instaurer une vision et des relations de long terme, persistantes, résilientes, sinon les projets ne pourront pas aboutir.
D’autre part, il faut savoir user des compétences de la diplomatie pour mettre en place de nouvelles formes de partenariat. Jusqu’à présent, les chaînes de valeur et les chaînes industrielles étaient très segmentées. Mais avec la digitalisation et la concurrence globale, une entreprise peut se retrouver avec des acteurs qu’elle n’avait initialement pas du tout dans son champ concurrentiel. Les GAFAM sont, par exemple, devenus de nouveaux concurrents pour beaucoup d’entreprises avec lesquelles ils n’étaient pas concurrents originellement. Les fournisseurs d’un jour sont les concurrents de demain, de nouveaux entrants troublent le jeu. Dans ce contexte, la nécessité n’est pas d’adopter une approche d’adversité à l’égard de ses concurrents, mais plutôt de penser les partenariats qui seront pertinents à certains moments pour progresser, de constituer les collectifs d’organisations permettant de réussir à créer les nouvelles structures de marché. Cela suppose de définir clairement les zones de partenariat possible et les lignes à ne pas franchir. A ce titre, peut-être certaines entreprises françaises ont-elles fait preuve d’une confondante naïveté à l’égard de transferts de technologie consentis. D’autres ont en revanche fait preuve d’une paranoïa excessive et n’ont pas su mettre les coalitions nécessaires.
Le troisième sujet est le déploiement de stratégies de l’information. Il ne faut pas sous-estimer ce facteur informationnel, le facteur des opinions, puisque les décisions peuvent aussi se prendre sur ces terrains-là. Cela peut constituer une grosse partie de la stratégie.
Enfin, il faut élaborer de nouvelles plateformes d’échanges. Le Choiseul Africa Business Forum qui se tiendra au Maroc du 19 au 21 octobre illustre bien cela : le cœur de cet espace sera l’échange entre dirigeants d’entreprises africains et européens. Ce n’est pas un forum soutenu par un seul et même pays mais un forum qui permet justement d’échanger entre Etats, entre communautés, et entre dirigeants. Ces nouvelles formes de dialogue sont aussi la clé du nouveau système mondial qui est en train de se constituer. Il permet ainsi de sortir de systèmes de domination périmés pour aller vers des partenariats bénéfiques à toutes les parties prenantes.
La notion de souveraineté est beaucoup traitée dans votre ouvrage. Comment appréhender cette notion pour les Etats mais aussi pour les dirigeants d’entreprises ? Comment doit-on être souverain ?
AM : La question de la souveraineté est très importante. La classe politique et les médias en parlent d’ailleurs tous les jours. Ne nous gargarisons pas cependant des seuls mots mais donnons-leur du contenu.
Qu’est-ce que signifie être souverain ? De façon concrète, c’est s’interroger sur la maîtrise et le contrôle que l’on a de son destin ou d’un secteur d’activité. Ce concept de souveraineté est très concret, notamment dans les domaines de la défense, des frontières, etc. Dans le domaine de la défense nationale, la France est souveraine parce qu’elle possède la dissuasion nucléaire ; nous possédons donc les moyens de réagir, de résister ce qui nous permet, de ce point de vue-là, d’être maîtres de notre destin. Avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que l’OTAN est facteur de souveraineté européenne et atlantique.
Dans le domaine économique, le sujet de la souveraineté est extrêmement plastique et mouvant. Nous avons réalisé lors de la crise du Covid-19 – qui est d’ailleurs un facteur déclencheur de nombreuses de nos réflexions présentes dans ce livre – que le fait de ne pas être souverains dans la production de choses extrêmement banales comme les masques chirurgicaux pouvait handicaper toute une politique de santé publique dans notre pays. De même, le fait de ne pas être souverains dans la maîtrise et la production de principes actifs de médicaments et de tests a également rendu toute notre politique de santé publique inopérante et inefficace durant le démarrage de la pandémie. De surcroît, nous étions obligés de nous mettre à genoux devant les pays du Sud-Est asiatique pour être approvisionnés.
L’approche peut être totalement différente pour les entreprises dont les intérêts peuvent diverger de ceux des Etats. Prenons l’exemple de Photonis. Le gouvernement d’un pays peut, à un moment donné, se dire qu’il faut rester souverain dans la maîtrise de certaines technologies (en l’espèce de la vision nocturne). Dans ce cas précis, le gouvernement va expliquer à l’entreprise nationale concernée par ce domaine et à son fonds d’investissement qu’ils sont au cœur de la souveraineté du pays. L’Etat peut donc refuser une vente de l’entreprise aux Etats-Unis, afin de rester souverain sur cette technologie. Cela peut se produire alors même que le chef d’entreprise, lui-même, considère que la souveraineté correspond au fait de nouer des partenariats pour continuer à investir.
Tout cela génère des débats très importants dont il faut être conscient. Un dialogue permanent entre le monde économique et le monde public est indispensable. Il faut bien sûr effectuer un travail de recensement dans toutes les filières économiques et industrielles afin de connaître les besoins les plus importants et les plus stratégiques dans les processus de production, dans la gestion des sous-traitants, etc. C’est ainsi que l’on peut obtenir des grilles de lecture, tout en rappelant bien sûr que celles-ci seront évolutives et que ce qui est stratégique aujourd’hui peut ne plus l’être demain. Les exemples du livre, de ce point de vue-là, sont très éclairants.
Enfin, il est essentiel de comprendre qu’il existe des niveaux différents de souveraineté et qu’un pays ne peut pas être souverain sur tout, de façon générale et absolue. Cela induirait qu’il vive en autarcie en étant parfaitement indépendant. Dans le monde actuel, cela est impossible. La notion de souveraineté doit donc être, une fois de plus, bien définie et les niveaux de souveraineté doivent être acceptés en fonction des secteurs, des alliances possibles et supportables, etc. Ce qui ne serait pas acceptable, c’est d’être dépendant d’un seul Etat car il n’y aurait plus de souveraineté.
Cela se discute de manière très concrète, lorsque l’on parle de politique industrielle et de relocalisation. Lorsque l’on décide de relocaliser des activités industrielles parce que l’on est trop dépendant de l’Asie, on se rend compte que les conditions de réimplantation en France engendrent des coûts très importants qui ne sont pas toujours soutenables. Il est dans ce cas indispensable de nouer des partenariats au niveau européen – par exemple, avoir des ateliers de production dans des pays d’Europe centrale ou d’Europe de l’Est qui ont des conditions de productions différentes qui permettent un partage de souveraineté –, ou dans des pays méditerranéens tels que le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie qui sont des partenaires historiques de la France. Relocaliser nos productions issues du sud-est asiatique, dans le bassin méditerranéen, c’est être moins dépendant de l’Asie et être présent dans des pays stables politiquement avec lesquels nous avons des traditions de partenariats, ou qui sont membres de l’Union européenne. Les questions de souveraineté peuvent donc se décliner filière par filière, production par production, et ce de manière extrêmement variée, en évitant un repli total sur soi-même.
XD : Une de nos forces et atouts est que la France à une culture d’autonomie et a su conserver dans de nombreux secteurs ses propres capacités d’action, alors même que la doxa des quarante dernières années, qui insistait de façon excessive sur les avantages comparatifs, a conduit certains pays ou entreprises à se mettre en situation de trop forte dépendance. Nous avons des industries performantes dans la défense, l’énergie, l’agroalimentaire, la construction ou les secteurs du luxe et de la beauté, une armée relativement autonome, et une capacité de réflexion partiellement indépendante.
En revanche, ce travail est encore très limité à l’échelle européenne. Il est en train de se construire mais la France n’a pas encore réussi à convaincre certaines de ces parties prenantes européennes de la nécessité de faire avancer cette capacité d’autonomie. A vrai dire, elle ne s’en est pas encore suffisamment donné les moyens en mettant en place des stratégies de communication en Europe, auprès des populations européennes et des cercles de réflexion et de fabrication de la décision politique. Par exemple, quel think tank, quel média, quel laboratoire a travaillé de façon suffisamment soutenue en Allemagne pour défendre l’utilité de l’énergie nucléaire, l’autonomie énergétique et de ressources naturelles ou la convergence des visions stratégiques ?
D’une certaine manière, dans les 40 dernières années et dans ce système mondialisé, on a confié nos dépendances au marché. Ce marché a structuré le système de façon très efficace puisque les prix et les coûts ont baissé, les revenus ont progressé, etc. ; en revanche, il a aussi engendré des fragilités créées par la dépendance dont on ne sait que difficilement sortir. L’enjeu stratégique pour les Etats et les entreprises est aujourd’hui de savoir cartographier leurs dépendances et savoir là précisément à quel niveau ils ont besoin des autres – au-delà de vouloir tout faire indépendamment. C’est une des clés du nouveau paradigme que nous décrivons et le sujet prioritaire de souveraineté.
Au-delà de cette question de dépendance, il me paraît opportun de réhabiliter fortement la forme « Etat », qui a été fragilisée par la mondialisation et l’émergence des acteurs transnationaux. L’actualité montre la nécessité pour tout État de reprendre la main sur les leviers de leur souveraineté, de s’adjoindre des capacités pour peser face aux autres Etats et aux acteurs transnationaux, quels qu’ils soient, d’autant que l’on assiste à un accroissement des tentatives de déstabilisation à leur égard. C’est valable partout dans le monde en Europe, en Afrique ou en Asie.
Il y a un an, la mésaventure de Naval Group dans ses contrats en Australie avait fait beaucoup parler et entraîné une crise diplomatique majeure. Quels enseignements tire-t-on de cet évènement ?
AM : Il faut prendre conscience qu’il s’agit de processus au long cours. Il y a un temps pour la compétition, un temps pour les choix, un temps pour la mise au point des processus industriels des accords internationaux, de la sous-traitance, des productions locales, etc. Ce sont des affaires de long cours qui durent plusieurs années. De ce fait, une entreprise ou un Etat qui a mis en place des dispositifs permettant d’être bien placés dans la compétition (veille, surveillance, influence, soft power, hard power, etc.) ne doit pas suspendre ces outils en cas d’obtention dudit contrat. C’est très important puisque beaucoup de combats d’arrière-garde peuvent remettre en cause le choix.
C’est ce qui s’est passé dans le cas de Naval Group. Il y a eu un sans-faute du gouvernement français et de Naval Group pour remporter le contrat du siècle avec l’Australie. Mais une fois le choix effectué, les luttes d’influence, la complexité des contextes politiques locaux, l’activisme des concurrents, les alliances stratégiques, ne se sont pas arrêtés. Faute d’avoir maintenu un dispositif complet d’influence, la France et Naval Group n’ont pas vu venir la trahison de la part du gouvernement australien avec l’aide du Royaume-Uni et de la diplomatie américaine.
Il faut en tirer la leçon de rester vigilant en maintenant des dispositifs d’influence (veille, lobbying, etc.) jusqu’au bout du processus, même si cela est coûteux. Le coût en vaut la chandelle !
Dans ce monde fragmenté que vous décrivez, la France est-elle suffisamment bien armée en matière de soft power pour défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises ?
XD : En termes de soft power, nous avons une capacité à intervenir et à peser dans la structuration du nouveau monde en train de se créer (culture spécifique, puissance du droit, puissance économique, puissance culturelle, etc.). La France doit faire la même chose que les entreprises dans ce contexte. Nous avons maladroitement construit notre capacité de planification en termes de ressources, d’identification des zones stratégiques, de gestion d’énergie, de construction de bases industrielles. Avant de vouloir exercer du pouvoir ou de l’influence, il faut savoir ce que l’on veut obtenir. Il faut donc renforcer ces éléments d’anticipation ; cela fait tellement de temps que cette idée de long terme est répétée, sans que cela entraîne de décisions concrètes suffisantes, comme sur le sujet de la souveraineté en termes de ressources naturelles, que l’on finit un peu par désespérer du fonctionnement de nos institutions.
Mais dans le contexte précédemment décrit de fragmentation du monde et de reconfiguration des relations entre Etats, notre principal sujet est de revenir à notre utilité. On entend sans cesse : « la France perd en influence, il faut mettre en place des stratégies d’influence et regagner en influence ! », mais l’influence véritable ne se décrète pas, elle se mérite.
C’est ce renversement mental, de bon sens, qu’il faut bien saisir. Pour la mériter, il faut se poser quelques questions très simples : Quelle est l’utilité de la France pour les populations d’autres pays ? Qu’avons-nous à offrir ? Que pouvons nous apporter à d’autres et, en échange, que peuvent-ils nous apporter ? Je constate que le Président Macron dresse actuellement des perspectives de partenariat et de relations réciproques dans de nombreux pays amis de la France plutôt que de situations de dominant-dominé.
Dans ce que nous avons à offrir, il y a bien sûr ce que notre pays incarne, les valeurs qu’il promeut, dont il faut être fier et qu’il faut clarifier sans chercher à les imposer : notre respect des droits des individus ; la mise à l’abri de toutes celles et ceux qui souhaitent ne pas être soumis à des idées ou des puissances totalisantes (autrement appelée laïcité), une expérience séculaire de la qualité de vie, mais aussi, pourquoi pas, des plaisirs de la vie. Quoiqu’on en dise, tout ceci participe fondamentalement de notre attractivité. En jargon de communicant d’entreprise, on dirait qu’il faut revenir, sans arrogance, à la « raison d’être » de la France ! Par exemple, le général de Gaulle, dans l’un des moments de plus basses eaux que notre pays ait subi, rappelait le lien indéfectible entre la France et la liberté. Aujourd’hui, on a quelque peu perdu ces récits puissants : comment alors vouloir influencer qui que ce soit ? Nous les diffusons insuffisamment, ou de façon maladroite. Vladimir Poutine développe une vision très assumée d’un modèle culturel et social opposé à l’idée qu’il se fait de ce qu’il appelle l’Occident, postmoderne, décadent, pusillanime, étroitement matérialiste, déboussolé. La France a dans les deux derniers siècles proposé un autre modèle et une vision à elle, bien différente de ces deux modèles.
Au-delà des valeurs et de la vision, essentielles pour créer des affinités et de l’adhésion, il y a évidemment aussi la nécessité d’apporter des preuves tangibles, via nos capacités économiques, financières, de défense et d’ingénierie, etc.
AM : Le sujet de la perte d’influence de la France dans le monde et les éléments de continuité de la chaîne de soft power sont des sujets fondamentaux. Si la France est bien placée dans les classements internationaux de soft power, il n’en reste pas moins qu’il y a des éléments de cette chaîne de soft power qui doivent être renforcés. Il ne faut pas être naïf, il faut comprendre pourquoi on perd de l’influence – en Afrique notamment – pourquoi certains Etats et groupes de personnes tentent de monter populations et gouvernements contre la France.
Cette chaîne du soft power est très longue. Elle commence par l’éducation et la culture qui ont toujours été des atouts de notre pays (à travers la place des écoles et lycées français, de l’enseignement du français, de partage de valeurs françaises et manière de penser, etc.). Il faut impérativement que la France continue à y consacrer de l’argent pour continuer d’attirer les élites de pays étrangers, pour créer de nouveaux établissements scolaires. Les politiques restrictives de visa pour les étudiants sont une explication du recul de la place de la France dans le monde. Ce sont des mauvaises décisions qui font que les élites étrangères finissent par étudier aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, mais aussi en Chine ou en Russie. Je plaide pour que dans le domaine de l’éducation et de la culture, nous maintenions un haut niveau d’efforts. C’est un excellent investissement qui rejaillit sur l’économie française.
Un autre exemple que je cite souvent, c’est celui des cabinets de conseil. C’est assez frappant de voir que dans des pays importants pour la France, dans lesquels nous cherchons notamment à conquérir des marchés internationaux, nos entreprises font face à des consultants anglo-saxons qui conseillent gouvernements et Etats dans la rédaction de cahiers de charges de grands appels d’offres internationaux. Pas étonnant dès lors que les entreprises de la même nationalité soient favorisées. Ainsi, faut-il nous aussi mettre à disposition une expertise française auprès des Etats et gouvernements partout dans le monde. Cela permettra à la France de participer aux chaînes de décision et de production sur les grands contrats internationaux. La consultance internationale ne doit pas être uniquement anglo-saxonne.
Dans le domaine de l’information, il faut aussi avoir des outils d’information à la hauteur des enjeux numériques et digitaux. En France, nous avons des organes d’informations publics (RFI, TV5 Monde, France 24) qui ne sont pas au service du soft power français. Je comprends qu’il s’agisse d’organes indépendants dont la visée principale n’est pas d’être la voix de la France – et je suis très respectueux de l’indépendance éditoriale de nos médias – mais je constate que ce n’est pas ce que font les autres pays. Par exemple, la voix du Qatar par le biais de la chaîne Al Jazeera et d’AJ+ (digital) est très organisée. Cela représente un poids politique très important, ainsi que l’atteste le Printemps Arabe. De manière globale, l’outil de l’information est un sujet sur lequel la France est très en retard.
La charity est également un outil de soft power très important que l’on néglige en France. Le monde anglo-saxon en Afrique est très présent dans les églises évangéliques ; des financements du Qatar et de la Turquie sont également nombreux dans les domaines du développement (femmes isolées, éducation, etc.) dans le cadre de politiques publiques ou de fondations. La France ne le fait pas suffisamment.
Enfin, la France qui compte de très grandes entreprises présentes partout en Afrique comme Total ou Orange ne passe pas beaucoup de temps à organiser avec elles la manière dont elles peuvent participer aux réseaux d’influence de notre pays.
Tous ces points sont autant de pistes à considérer pour organiser une véritable stratégie de soft power français.